Asile et immigration: les chiffres 2019

Le Ministère des Affaires Etrangères vient de publier le bilan et les chiffres 2019 de l’asile et de l’immigration.
Une véritable mine d’informations sur l’asile, l’immigration et la libre circulation des personnes, le retour ds personnes en séjour irrégulier, le Centre de Rétention, la SHUK et l’ONA
Les échos de la presse :
paperjam 10.02.2020: Toujours plus de 2.000 demandes de protection internationale
Luxemburger Wort 11.02.2020 : Steter Zustrom
Luxemburger Wort 12.02.2020 Edito : Vielfalt führt zum Erfolg
Le Quotidien 11.02.2020 Dossier
Woxx 13.02.2020 Flüchtlingspolitik: Theorie gut, Praxis nicht so
L’édito du Land 13.02.20 : L’humaniste et les technocrates
Il est comme ça, Jean Asselborn, le vieux briscard de la stratégie politique, un demi-siècle d’expérience. Les chiffres précis, les détails, les statistiques ne l’intéressent pas des masses. En présentant lundi, d’abord devant les députés, puis devant les journalistes, les chiffres de l’asile et de l’immigration pour 2019, que de nombreux fonctionnaires dévoués ont compilés dans un travail de bénédictin, rassemblant les nombres de nouvelles demandes de protection internationale en 2019 (2 047), de « Dubliners » renvoyés vers le premier pays d’entrée sur le territoire européen, les taux d’obtention du statut (trente pour cent), le hit-parade des nationalités (Érythrée, Syrie, Afghanistan, Iraq) ou le taux d’occupation des foyers d’accueil dont il a aussi la responsabilité depuis la fusion de l’immigration et de l’accueil, Jean Asselborn y passa au grand galop. « Ces chiffres, vous les avez dans le document », ou « J’ai été visiter l’Ona1, là, au Kirchberg, c’est bien fait… », furent quelques-unes de ces phrases typiquement Asselborn.
Lui, son truc, ce sont les déclarations politiques, les grands principes d’humaniste vieux jeu, qui rappelle toujours et encore à quel point le Luxembourg a tout à gagner d’une politique d’immigration généreuse, à quel point les nouveaux arrivants, quels que soient leur provenance ou leur statut juridique, contribuent à la croissance économique du pays. Et que de compter parmi les rares pays européens à toujours être prêt à accueillir des naufragés en attente sur un bateau de sauvetage bloqué dans un port grec, italien ou espagnol, est une question de solidarité et de responsabilité.
En une heure de monologue, juste avant de recevoir Michel Barnier pour parler des négociations post-Brexit, Jean Asselborn a surtout fait une profession de foi, délivré un grand credo politique. Sachant le sujet de l’immigration délicat, surtout depuis qu’une partie de l’ADR tente offensivement de l’instrumentaliser pour récupérer la frange de la population qui s’estime laissée-pour-compte, il a eu son moment Don Camillo et Peppone : le curé et le communiste qui, finalement, partagent les mêmes réflexes et ne pouvant que s’allier pour la bonne entente de leur communauté. Asselborn le socialiste, qui est loin d’être une grenouille de bénitier, s’est publiquement allié au cardinal Jean-Claude Hollerich, le remerciant pour son engagement en faveur des réfugiés, « si important, parce qu’il [Hollerich] rappelle qu’il ne s’agit pas d’une question de défense du catholicisme face à une menace d’islamisation ». Une belle ruse pour fermer les rangs dans la population, signifiant que, de gauche à droite, le pays est uni dans cet humanisme.
En réalité, le plaidoyer de Jean Asselborn était peut-être aussi une réponse tardive au président du Tribunal administratif Marc Sünnen, qui, dans le dernier rapport annuel de la Justice, avait reproché au ministre un « déni des principes essentiels de l’État de droit » parce qu’il utilise, dans certains cas, moins d’une centaine en 2019, le « principe de souveraineté », qui permet au ministre de passer outre une décision de justice, dans des cas particuliers en matière d’asile. Car, estimait le magistrat, le tribunal est surchargé de recours contre des décisions en la matière, et les magistrats sont frustrés parce qu’à la fin, le ministre, alerté par des représentants des ONGs, passe outre leurs décisions. Il s’agit souvent, savons-nous de la part de militants engagés, de situations particulièrement dramatiques, où les concernés ont vécu des traumatismes durant leur périple (ce qui n’entre pas en ligne de compte pour la reconnaissance du statut de Genève), ou des cas de regroupements familiaux, dans lesquels l’application stricte de la loi décimerait des familles. « C’est au ministre de statuer en dernière instance, souligna Jean Asselborn. Il est alors tout seul et doit agir en âme et conscience. C’est là que compte alors son humanité ! ».
1 Office national de l’accueil, qui gère les 4 000 lits dans les foyers pour demandeurs de protection internationale et leur encadrement psychosocial ; il remplace, depuis le début de cet année, l’Olai et a également changé de ministre de tutelle, quittant celui de l’Intégration pour rejoindre celui des Affaires étrangères et de l’Immigration.
 Depuis le 1 janvier 2020 l’OLAI n’existe plus et a été scindé en 2: l’Accueil au sein de l’ONA (Office National de l’Accueil) au Ministère des Affaires Etrangères et de l’Immigration et l’Intégration dans le nouveau département Intégration du Ministère de la Famille et ceci par la
Depuis le 1 janvier 2020 l’OLAI n’existe plus et a été scindé en 2: l’Accueil au sein de l’ONA (Office National de l’Accueil) au Ministère des Affaires Etrangères et de l’Immigration et l’Intégration dans le nouveau département Intégration du Ministère de la Famille et ceci par la 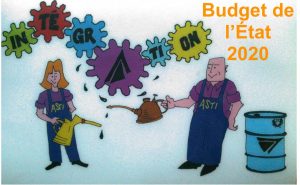 Le projet de Budget de l’État pour 2020, sans faire des questions du « Vivre ensemble » une priorité, laisse entrevoir des signaux positifs qu’il faudra confirmer dans la pratique.
Le projet de Budget de l’État pour 2020, sans faire des questions du « Vivre ensemble » une priorité, laisse entrevoir des signaux positifs qu’il faudra confirmer dans la pratique. Nouvelle Constitution luxembourgeoise : une copie à revoir
Nouvelle Constitution luxembourgeoise : une copie à revoir